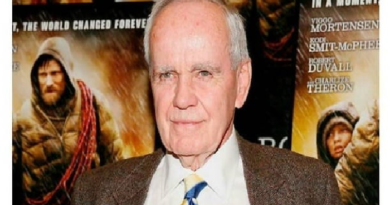Opération Barkhane: «Il faudrait que la société française puisse débattre des guerres que mène la France»
Ce 11 janvier, cela fait dix ans tout juste que la France a lancé ses opérations de lutte anti-jihadiste au Sahel; l’opération Serval – qui s’est transformée en Barkhane – et qui est entrée depuis la fin de l’année dernière dans une nouvelle phase de transformation. Il y a dix ans, l’arrivée de Serval était saluée par la population malienne. Dix ans plus tard, l’incapacité à mettre fin aux activités des groupes jihadistes nourrit la colère et les réactions de rejet dans les pays sahéliens. Comment expliquer ce basculement ? La question est au cœur d’un ouvrage qui vient d’être publié : Mirage sahélien. La France en guerre en Afrique. Serval, Barkhane et après ?. Son auteur, le journaliste français Rémi Carayol, est l’invité de RFI.
Vous décrivez dans votre livre certaines idées sur lesquelles se sont fondées les opérations françaises Serval puis Barkhane, des schémas parfois ethnicistes ou racialistes, de vieilles conceptions. D’où viennent ces schémas, et à quels genres d’erreurs peuvent-ils conduire ?
En fait, il faut savoir que la colonisation représente dans l’imaginaire de l’armée de terre française une période de gloire. Il y a des conquêtes, des guerres très glorieuses, et puis il y a des officiers qui ont fait toute leur réputation durant cette période. Je pense notamment à Lyautey, à Gallieni, des officiers qui aujourd’hui encore occupent une place importante dans les conceptions stratégiques de l’armée française.
Et lorsque l’armée intervient en 2013 dans cette zone, elle recycle cette stratégie qui avait été mise en place durant la conquête coloniale. Ça a conduit notamment, entre autres, à des alliances avec des groupes armés, fondées notamment sur ce que j’appelle le « mythe de l’homme bleu » c’est-à-dire la croyance qu’on peut compter sur les Touaregs dans une forme d’essentialisation de ce qu’ils sont pour mener le combat contre les groupes jihadistes, mais aussi une alliance que je qualifie de coupable, avec deux groupes armés : le MSA et le Gatia. Il se trouve qu’alors que l’armée française coopérait avec ces groupes armés, ceux-ci commettaient des exactions contre des civils peuls, dans la région des trois frontières.
L’une des erreurs d’analyse majeure qui est faite, estimez-vous dans votre ouvrage, c’est celle qui consiste à ne voir dans les insurgés de cette zone que des terroristes affiliés aux grands réseaux jihadistes internationaux, alors expliquez-vous, qu’il faudrait s’efforcer de saisir dans toute sa complexité ce que vous appelez un « jihad rural » qui s’est développé sur fond de révolte sociale ?
Oui, et ça je suis loin d’être le seul à le dire, énormément d’études, de chercheurs, énormément de reportages aussi de journalistes ont démontré que les ferments de ces insurrections, qui sont des insurrections à la base locales, reposent sur des enjeux très locaux, voire micro-locaux. Tout ça, effectivement, s’est moulé dans ce qu’on appelle le jihad global avec des groupes comme le JNIM et l’EIGS qui sont effectivement alliés à al-Qaïda et au groupe État islamique. Le problème est que les responsables français n’ont pas voulu voir cette évolution, parce que effectivement en 2013 lorsqu’ils interviennent, on peut réduire l’ennemi à ce volet uniquement « terroriste ». Mais entre 2015 et 2017, tout a changé en fait, on se retrouve face à des insurrections locales qui doivent appeler une réponse autre que militaire. D’ailleurs, très rapidement, les responsables politiques, les notables, les responsables communautaires au Mali, émettent le vœu d’entamer des discussions avec certains chefs des groupes jihadistes. En voulant à tout prix employer la force et uniquement la force pour battre ces « terroristes », on n’a pas voulu voir la possible sortie par la voie politique et le dialogue.
Une des parties de votre ouvrage porte sur les dérives qui se sont produites au cours de ces dix ans d’opération dans le Sahel, vous citez notamment ce qui s’est passé dans la localité de Bounti dans le centre du Mali. Et vous revenez aussi sur l’existence d’une prison dans le camp de Gao, une prison à laquelle l’armée ne laisse pas accéder la division des droits de l’homme de la Minusma, et les associations maliennes des droits de l’homme… Que montrent selon-vous ces dérives, et la façon dont elles ont été gérées par l’armée ?
L’absence totale de transparence de la part de l’armée – on va dire que c’est une caractéristique de l’armée française qui est dénoncée par pas mal de chercheurs qui ont eu à travailler avec d’autres armées. Cette prison, en soi, elle était connue par les autorités maliennes, puisque le fait que les Français puissent garder des suspects pendant un certain temps est inscrit dans l’accord qui a été signé en 2013 entre la France et le Mali. Mais par contre, son existence n’a été divulguée à personne d’autre et comme vous le dites, il n’y avait aucun contrôle. On ne sait pas ce qu’il s’y passait hormis les quelques témoignages des personnes qui y sont passés…
… Et qui disent ?
Et qui disent qu’elles étaient plutôt bien traitées. Je n’ai pas, moi, documenté d’acte de torture par exemple. On est loin de l’image de prison par exemple américaine en Irak, on n’est pas du tout dans cet ordre-là. Par contre, ce dont elles se plaignent, c’est le fait que lorsqu’elles ont été remises aux autorités maliennes, elles ont été oubliées, abandonnées. Ces gens ont croupi en prison pendant un, deux, trois ans, et le seul moyen pour eux d’en sortir a été de soudoyer un magistrat parce que dans cette prison, ils ne voyaient ni avocat, ni famille, ni juge.
Finalement, l’un des soucis majeurs, c’est que les citoyens français n’ont pas pu réellement exercer un contrôle démocratique sur cette opération, au travers de leurs élus ou au travers de la société civile ?
Oui, c’est la raison pour laquelle j’ai écrit ce livre. Je voudrais que la société française, en fait, puisse débattre des guerres que mène la France. Il n’y a aucun contrôle démocratique sur ces guerres-là, les parlementaires n’ont que peu de pouvoir avec la Constitution, mais quelque part, ils ne font rien pour changer cela. Les citoyens finalement n’ont pas de voix qui leur permet de poser des questions sur pourquoi on est en guerre en notre nom.